
Alors qu’il est déjà aux prises avec la persistance de la faim, le continent africain est de plus en plus confronté à l’explosion de l’obésité, notamment dans ses zones urbaines. Si l’ampleur du phénomène est planétaire, les défis qui attendent le continent africain restent cependant considérables, tant le phénomène est complexe. Gros plan sur la situation de l’obésité en Afrique, ses enjeux et les solutions possibles, avec Nicolas Bricas, agro-économiste au CIRAD et dirigeant de la Chaire Unesco Alimentations du Monde (AdM).
Agence Ecofin : De nombreux rapports ont fait état, ces dernières années, d’une progression de l’obésité sur le continent africain. Certains pointent du doigt une baisse de l’activité physique ou encore une consommation alimentaire déséquilibrée des populations urbaines. Quel est votre avis sur le sujet ?
Nicolas Bricas : Je ne crois pas que cela soit l’un ou l’autre. On a vraiment une combinaison de facteurs qui expliquent l’épidémie d’obésité, tels que l’activité physique et la consommation alimentaire. En milieu urbain, les activités exigeantes du point de vue physique diminuent proportionnellement dans la population, par rapport au milieu rural parce qu’il y a plus d’activités sédentaires, plus de transports motorisés, en particulier dans les classes les plus aisées de la population urbaine qui sont d’ailleurs les premières touchées par l’obésité.
Dans cette classe, il y a non seulement une diminution de l’activité physique, mais aussi une consommation des produits alimentaires en plus grande quantité. Il y a une disponibilité permanente d’aliments, contrairement à une certaine époque où on pouvait avoir des périodes de soudure dans l’année. Il ne manque jamais de nourriture dans les villes. Donc, on mange plus et plus régulièrement, mais on consomme de plus en plus des produits gras, sucrés et salés. Il faut dire aussi qu’il y a une préférence pour ces articles alimentaires, qui s’est construite dans une période de plus grande rareté. Les populations valorisent d’autant plus ces produits parce qu’ils étaient autrefois relativement rares, peu accessibles et relativement coûteux. En milieu rural, les produits gras, sucrés et salés étaient relativement coûteux et peu accessibles et quand on pouvait les consommer, on les appréciait parce qu’on n’avait pas la chance d’en manger souvent.
Etant donné que le pouvoir d’achat augmente, on accède plus facilement à ces produits sucrés, notamment les boissons sucrées. On a aussi un développement considérable de la mayonnaise et des plats gras qui étaient peu communs, mais aussi de produits particulièrement salés. Un autre facteur est le phénomène que l’on nomme « la programmation fœtale de l’obésité » et qui est une contribution à l’explication de l’explosion de l’obésité qu’on observe, en particulier dans les classes aisées urbaines. Ce phénomène montre que les femmes enceintes qui sont en situation de relative carence en éléments nutritifs vont donner naissance à des enfants qui, à consommation égale avec des enfants nés de femmes mieux nourries, seront plus susceptibles d’être obèses. C’est en effet comme si une femme souffrant de carence engendrait des enfants avec un meilleur rendement d’absorption de la nourriture qui, une fois dans une situation de facilité de consommation, auront plus tendance à grossir.
Il faut aussi dire que l’offre alimentaire n’est pas seulement une réponse à la demande ou aux souhaits des consommateurs, elle entretient aussi la demande et pousse à la consommation. Le fait que les produits soient omniprésents dans l’environnement des villes et à la portée de toutes les bourses stimule leur consommation. Par exemple, si vous avez une réunion de bureau et qu’il y a des boissons sucrées sur la table, vous aurez tendance à les boire parce qu’ils sont sous votre nez. Si on avait mis de l’eau, vous l’auriez bue.
Dans certaines zones, vous avez aujourd’hui plus facilement accès à de la boisson sucrée qu’à de l’eau minérale ou potable. Pour finir, je dirai que la question de l’obésité se joue également sur le plan de l’image du corps. On est dans des sociétés qui, il y a quelques décennies encore, étaient majoritairement en milieu rural, avec beaucoup d’activités physiques et une consommation moins calorique qu’aujourd’hui. Dans ce contexte, les gens qui avaient un certain embonpoint et pas forcément obèses étaient socialement valorisés parce qu’ils appartenaient à la catégorie la plus riche de la population rurale.
L’image du corps un peu rond était perçue comme valorisante parce qu’elle était relativement rare et parce qu’il n’était pas aussi simple et facile d’avoir de l’embonpoint.
Cette image socialement valorisée du corps plus rond continue d’exister, même si aujourd’hui il devient beaucoup plus facile de devenir gros qu’auparavant. De ce fait, si les individus entendent de plus en plus qu’être un peu gros est un facteur d’apparition du diabète ou des problèmes articulaires, ce risque est compensé par l’image sociale positive que confère le fait d’avoir un certain embonpoint. Les épidémiologistes pensent que cette image valorisante de corps rond pourrait progressivement être nuancée si les individus prennent conscience qu’elle est associée à l’obésité. Il y a des gens qui pensent qu’au fur et à mesure que cela va poser un problème de santé publique, il finira par se diffuser une image d’un corps plus mince et socialement désirable. Cette hypothèse d’une transition n’est pas vraiment vérifiée. On ne sait pas combien de temps va durer la valorisation sociale d’un homme ou d’une femme qui a de l’embonpoint.
AE : Certains observateurs mettent l’accent sur un début de mimétisme de la consommation alimentaire urbaine occidentale dans des villes africaines. D’autres vont jusqu’à parler de « mac-donaldisation » avec le récent développement des chaînes de restauration rapide. Qu’en pensez-vous ?
NB : Je pense que c’est plus une façon de parler qu’une réalité, dans le sens où très concrètement, en Afrique urbaine, la consommation de hamburgers reste extrêmement limitée. Même s’il y a quelques restaurants qui se multiplient et qui proposent ce type d’aliments, la majorité de la population ne consomme pas de hamburgers de manière massive.
S’il est vrai que l’offre en produits gras, sucrés et salés, proposés notamment par les firmes américaines, peut contribuer au phénomène, il faut souligner que ces types d’aliments sont loin d’être uniquement des produits types américains. Ils sont aussi issus de l’artisanat alimentaire ou des vendeuses de rues. Par exemple, on a la diffusion du « thièbou-djène », principal plat national sénégalais dans toutes les villes africaines sous la forme du riz avec poisson ou du riz au gras qui est la version avec plutôt de la viande, la vente de beignets, de boissons sucrées même en sachets plastiques, la vente de riz au gras dans les petits restaurants populaires. On ne peut pas dire que cela correspond à une macdonaldisation de l’alimentation dans les villes africaines. Je comprends tout à fait qu’on puisse dénoncer le rôle de certaines multinationales mais je pense qu’à la limite, c’est autour des boissons gazeuses et des sodas qu’on peut chercher un véritable facteur d’accroissement de l’obésité, plutôt qu’autour des hamburgers qui ne me semblent pas aujourd’hui un problème majeur.
AE :Quelles sont les régions ou les pays du continent qui sont les plus touchés par l’obésité ou sont plus prédisposés à le devenir ?
NB : Je n’ai pas encore eu à comparer les chiffres de la population obèse ou en surpoids entre les pays du monde. Je pense que cela a déjà dû être fait par ces analystes qui ont essayé d’étudier les différences. Cela étant, ce que je peux dire, c’est qu’en Afrique, au nord du Sahara, le phénomène est beaucoup plus important que dans la zone subsaharienne. Mais je ne saurais dire s’il y a une différence entre Abidjan, Dakar, Douala, Harare, le Cap, Addis-Abeba ou même Nairobi.
Clairement dans toutes les villes africaines, on constate une progression des pourcentages d’obésité. Cela parfois à l’intérieur d’une même famille, voire chez un même individu, où on note une surconsommation calorique et de carence en micronutriments.
On observe par exemple, dans des familles, des gens qui sont obèses, mais présentent des carences en Fer ou en Vitamine A. C’est cela aussi la nouvelle complexité de l’équation. La montée de l’obésité ne s’est pas faite après la disparition des maladies de carence. On a les deux qui coexistent dans un même pays, entre milieu rural et urbain, dans une même ville, entre riches et pauvres, au sein d’une même famille entre parents et enfants... On peut être en surpoids, voire obèse, et être carencé dans certains micronutriments.
AE : C’est ce que l’on nomme le double fardeau de la malnutrition ?
NB : En fait, on parle même de triple fardeau, parce que dans un pays donné vous pouvez avoir des gens qui sont en insuffisance de consommation calorique, en particulier en milieu rural, des individus qui présentent des carences en micronutriments et des gens qui sont en surpoids ou en situation d’obésité. Et je pense qu’on peut même déjà commencer à parler de « quadruple fardeau », si on ajoute à ces trois problèmes nutritionnels, le début du développement de maladies ou de pathologies liées à la consommation de produits chimiques.
A côté des risques classiques liés aux problèmes de qualité microbienne, on voit aussi des problèmes liés aux pesticides, aux métaux lourds, aux résidus de plastiques, notamment dans les zones périurbaines. Ces nouveaux problèmes que l’on rencontre déjà très couramment dans les pays industrialisés, depuis longtemps, arrivent aujourd’hui en Afrique, plus particulièrement sur la question des pesticides.
Même si un certain nombre de pesticides sont interdits d’usage dans les pays industrialisés, on continue à en trouver dans les pays africains. Ils circulent en Afrique, parfois clandestinement. On les trouve sur le marché avec des producteurs qui ne sont pas toujours formés à leur usage et qui parfois en mettent plus que nécessaire. Certaines des contaminations liées aux résidus de pesticides s’avèrent être aussi des facteurs de l’accroissement de l’obésité et on commence à s’en rendre compte dans les pays industrialisés. Ils jouent sur les milliards de microbes qui forment la flore intestinale. Ce microbiote intestinal a un rôle fondamental sur notre santé et en particulier sur la régulation de la digestion. On commence par s’apercevoir que la consommation de produits contenant des composés chimiques modifie la qualité de notre microbiote intestinal, ce qui provoque un certain nombre de pathologies, dont l’obésité.
AE : Parmi les solutions possibles contre l’obésité, on parle de politiques alimentaires tournées vers une transformation des produits ruraux avec des approches plus focalisés sur la dimension qualitative.
NB : Oui, bien sûr. Mais je dirai que la difficulté qu’on a aujourd’hui c’est qu’il y a 20 ans, le problème alimentaire en Afrique était essentiellement perçu comme un problème d’insuffisance des quantités produites pour nourrir une population en pleine croissance. On reste très imprégnés en Afrique des questions de sécurité alimentaire, dans le sens où on veut produire suffisamment pour nourrir la population qui s’accroît, s’appuyer sur le marché local plutôt que d’importer du blé, du riz, de l’huile, du lait, du sucre du marché international. En gros, je dirai que la problématique alimentaire dans l’élaboration des politiques est encore très dominée par une vision « calorique » et par une vision d’indépendance du marché vis-à-vis du marché international. Dans ce contexte, les questions de qualité de cette alimentation, en matière de teneurs en sucre, en matières grasses, en sel, mais aussi de résidus de pesticides sont un peu au second plan. C’est là où réside la difficulté. Le développement de l’obésité a eu lieu d’une manière assez brutale et rend nécessaire un changement de l’approche de la question alimentaire pour se rendre compte que l’enjeu n’est pas seulement de produire assez de produits de base comme le riz, le maïs et l’igname, mais aussi d’inclure des fruits et légumes, des huiles ou du sucre.
Il y a une nouvelle façon d’aborder la question, par exemple, celle de la création d’environnements alimentaires, c’est-à-dire un système qui permet de suivre les stocks, notamment ce qu’il y a dans les magasins, les prix afin qu’ils soient plus favorables à la santé alors qu’aujourd’hui, ils sont relativement favorables à l’obésité. Il faut que ces questions deviennent une préoccupation majeure des politiques alimentaires et cela suppose aussi le fait de former des gens capables de faire des analyses ou de proposer des alternatives.
AE : Selon vous, quelles actions peuvent être menées par le secteur privé ou public afin de réduire le phénomène ?
NB : Je pense qu’il y a matière à réfléchir autour de la question des boissons sucrées qui sont un facteur très important, en particulier du sucre qui est un grand responsable de l’obésité. Il y a des pays qui réfléchissent à l’interdiction de la publicité pour ses produits vis-à-vis des enfants, l’introduction d’une offre plus saine et moins favorable à l’obésité dans la restauration scolaire. Les cantines peuvent être, de ce point de vue, un levier intéressant. On parle aussi beaucoup de sensibilisation de la population sur ces risques. Cela est sans doute nécessaire mais en même temps, on sait très bien que cela ne suffit pas pour que les individus adoptent des comportements favorables à la santé, surtout quand on leur propose de façon omniprésente, absolument partout dans la ville, des produits comme les boissons sucrées.
Il faut aussi réfléchir à l’image du corps qu’on véhicule, si elle valorise une désirabilité de la rondeur ou non, par exemple. Une partie de la solution est aussi la lutte contre les pesticides parce qu’on connaît leur contribution au phénomène et aussi dans la considération de l’état nutritionnel des jeunes filles en âge de procréer. Je pense qu’à une pluralité de facteurs explicatifs doit correspondre une pluralité d’actions. Cela est compliqué parce que ça suppose de favoriser l’activité physique, de jouer sur les modes de production agricole pour réduire des pesticides, de jouer sur l’offre alimentaire dans les quartiers pour promouvoir les fruits et légumes et moins les produits gras, sucrés et salés, de jouer sur la régulation du commerce pour réglementer la publicité, de jouer sur la nutrition des femmes, en particulier celles en âge de procréer, voire de jouer aussi sur les prix.
La grande leçon qu’on peut tirer des pays qui se sont attaqués à ce problème est que la seule réponse efficace que l’on puisse imaginer est une combinaison d’actions coordonnées intersectorielles qui vont concerner à la fois l’agriculture, la santé, le commerce, l’éducation et l’urbanisme. L’obésité n’est pas un phénomène simple et n’appelle pas de simple réponse, malheureusement.
AE : En parlant de mesures publiques, le gouvernement sud-africain a imposé une taxe sur les boissons sucrées, depuis avril 2018, afin de limiter le développement de l’obésité. Que pensez-vous d’une telle mesure ?
NB : En Afrique du Sud, les industriels sont évidemment vigoureusement contre cette imposition fiscale parce qu’ils n’ont pas envie de voir diminuer leurs parts de marché. Mais je pense que la taxe sur les boissons sucrées est un point qu’il faut absolument discuter et étudier parce que le sucre est un des grands facteurs responsables de l’accroissement du poids. Cependant, appliquer uniquement une taxe ne suffira pas du tout. Le fait de jouer sur les prix est un élément important, mais fait partie intégrante d’un paquet de mesures qu’il faut mettre en œuvre.
AE : Etes-vous optimiste ou pessimiste quant à la capacité du continent à faire face à l’obésité en sachant que le phénomène vient s’ajouter au problème de la faim qui est encore très présent ?
NB : Dans toutes les sociétés du monde, les problèmes s’ajoutent. Il y a toujours plus de problèmes. Je ne connais pas de sociétés qui aient de moins en moins de problèmes. En Europe, on a de plus en plus de problèmes de natures différentes. Après, pour ce qui est de l’avenir, moi je suis plutôt optimiste. Je suis très optimiste sur l’Afrique au sens où j’ai commencé à y travailler, il y a une trentaine d’années. Les plus alarmistes parlaient à cette époque de l’explosion démographique, de l’agriculture qui ne suivait pas le rythme et de l’Afrique qui allait être complètement nourrie par les importations alimentaires. 30 ans après, je vois que la population a effectivement explosé mais les villes n’ont jamais manqué de nourriture. Oui, les villes recourent effectivement aux importations, mais elles sont très majoritairement nourries par les produits locaux : du maïs, du manioc, de l’igname, du plantain, du niébé, des huiles locales. L’alimentation des villes ne s’est pas pour autant occidentalisée.
L’Afrique a aussi inventé sa cuisine urbaine qui n’est pas une pâle copie de la cuisine occidentale. On parle de thiébou-diène au Sénégal ou de garba (plat à base de semoule de manioc, ndlr) en Côte d’Ivoire. Par rapport aux inquiétudes qu’on pouvait avoir, il y a 30 ans, je trouve que l’Afrique a relevé des défis considérables. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas de problèmes. Il y a des problèmes mais comme partout ailleurs. Je pense qu’on peut se battre et trouver des solutions collectives. Ce qui me rendrait inquiet c’est de laisser croire que les problèmes sont simples et que les solutions sont simples. Les problèmes sont multifactoriels et complexes et ils appellent des solutions multifactorielles et complexes.
Les défis que l’Afrique a relevés jusqu’à présent sont énormes, par rapport aux défis que l’Europe a rencontrés au cours de son histoire. La vitesse d’urbanisation de l’Afrique est sans précédent dans l’histoire du monde, mais il n’empêche que l’Afrique a toujours nourri ses villes.
Propos recueillis par Espoir Olodo
Agence ECOFIN





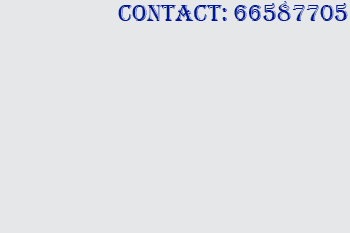






Recent Comments
Un message, un commentaire ?