
Si nous ne voulons pas que nos jeunes basculent dans la violence, nous devons, par nos actes, leur prouver notre propre attachement au respect des lois et de leurs droits. Car le sentiment d’impuissance face à l’injustice constitue un cocktail explosif qui, tôt ou tard, finit par nous exploser à la figure. A la manière du sociologue Pierre Merle dans son ouvrage publié en 2005 sous le titre « L’élève humilié », Denis Dambré se pose ici la question de savoir si, par hasard, l’école burkinabé serait « un espace de non-droit ». Il part d’un souvenir d’école datée du milieu des années 1970 où la réponse apparaissait sans ambiguïté pour montrer que les choses ont heureusement évolué dans le bon sens, même si d’autres formes insidieuses de violence perdurent
Le passage en première année de cours moyen (CM1) a laissé en moi un souvenir inoubliable. Nous quittions la classe d’une institutrice compétente et agréable qui nous enseigna durant les trois années précédentes pour entrer dans celle d’un maître dont la sévérité, accentuée par un penchant certain pour l’alcool, alimentait les rumeurs dans la cour de récréation.
Sans doute désemparés par son humeur imprévisible, les élèves des promotions précédentes avaient cherché quelques signes annonciateurs de ses manifestations de violence et avaient élaboré une théorie naïve à ce sujet. En début d’année, ils nous avaient raconté en guise d’avertissement que la sévérité du maître se manifestait surtout les après-midi où, les yeux rougis par la bière de mil, il revenait à l’école portant sa chemise rouge. Nous étions donc terrorisés par la couleur rouge.
Le maître arrivait toujours en retard après la pause méridienne, mais nous avions pour consigne d’entrer en classe à la sonnerie et d’apprendre sagement nos leçons en l’attendant. Dès que se faisait entendre le bruit singulier de son cyclomoteur, nous regardions par la fenêtre pour savoir s’il portait sa chemise rouge.
De même, lorsqu’il entrait dans la salle de classe, nous nous mettions debout et scrutions à la dérobée ses yeux pour savoir s’il avait bu de l’alcool. Il devait en boire tous les jours, car ses yeux avaient invariablement la même couleur rouge.
Je me rappelle la terreur qui nous saisissait lorsqu’il entrait dans la salle de classe. Il nous laissait debout, traversait les rangs jusqu’à son bureau, jetait un œil rouge-sang sur nous avant de nous lancer un « Asseyez-vous ! » terrifiant qui, certains jours, se résumait à un simple « Assis ! » – comme s’il s’adressait à une meute des chiots obéissants.
Les après-midi de dictée me sont particulièrement restés gravés dans la mémoire. Après nous avoir ordonné de nous asseoir, il nous commandait de prendre notre cahier de devoirs, d’écrire la date du jour, puis de noter "Dictée". Ce mot suscitait en nous une peur indescriptible, rien que par sa consonance. Il faut souligner
que « trembler » se dit « digi » en moré, de sorte que "dictée" évoquait un peu trop l’idée de tremblement.

Nous connaissions en effet le tarif que le maître appliquait pour chacune de nos fautes. Pour une faute d’orthographe, nous étions payés d’un coup de cravache. Pour une faute de grammaire, de deux coups du même instrument de torture. De sorte que les malheureux d’entre nous qui avaient des difficultés avec la langue de Molière et commettaient beaucoup de fautes rentraient chez eux le corps balafrés par les coups.
Heureusement, les vêtements étaient là pour cacher les blessures. Car, lorsque les parents s’apercevaient en plus que leur enfant avait été battu par le maître, ils doublaient le tarif de leur côté. Eux, qui n’avaient jamais été à l’école mais pressentaient que l’avenir de leur progéniture s’y jouait, accordaient une confiance aveugle aux maîtres. Nous étions donc cernés par le monde impitoyable des adultes.
Lorsqu’on a survécu à cela, on ne peut que se réjouir aujourd’hui que l’école burkinabé n’en soit plus là. A moins alors de vivre dans le déni, c’est-à-dire dans le refus d’une réalité perçue comme trop dangereuse ou trop douloureuse pour soi.
Certes, le décret n° 2008-236 du 22 mai 2008 qui interdit les châtiments corporels et réglemente les sanctions à l’école n’est pas exempt de critiques. Mais il constitue une avancée dans un pays qui, depuis 1990, a signé et ratifié la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). D’ailleurs, nombre de parents d’élèves n’hésitent plus à manifester leur désaccord devant certains actes de violence de la part des enseignants, voire à porter plainte.
N’en déplaise aux nostalgiques de l’école d’antan, cette évolution est une bonne chose. Car l’apprentissage de la citoyenneté, qui implique le respect des lois, fait partie des missions de l’école. Quel crédibilité auraient les enseignants à apprendre aux enfants le respect des lois si eux-mêmes les bafouent en frappant, en insultant ou en humiliant les enfants ?
Mais un détail mérite attention dans le récit ci-dessus. Les retards répétés du maître sont soulignés sans que, peut-être, le lecteur burkinabé ne s’en offusque outre mesure ; car il sait que cela est plutôt banal dans les services.
Mais quel message subliminal envoyait ainsi le maître à ses élèves ? Il leur envoyait inconsciemment – car je ne doute pas de la sincérité de ce maître d’école de l’époque – le message que les adultes ont des droits que les enfants n’ont pas ! Que les règles de ponctualité qu’on impose aux enfants à l’école ne sont valables que le temps que dure l’école. Car, comme lui, ils pourront s’exonérer de leur respect une fois devenus adultes !
N’est-ce pas un message désastreux pour l’avenir d’un pays ? On comprend mieux pourquoi, depuis des années, beaucoup de serviteurs sincères de l’Etat burkinabé arrivent en retard au service sans que cela ne les dérange. Ils ont eu des éducateurs qui leur ont donné, de façon subliminale, le mauvais exemple.
Moralité : si nous voulons que nos jeunes respectent les règles de l’Etat de droit, commençons par être nous-mêmes exemplaires dans notre conduite.
Denis Dambré, proviseur de collège
Kaceto.net





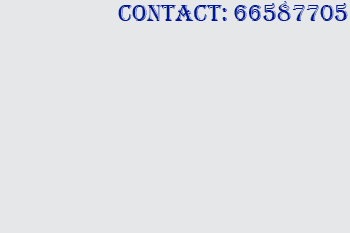






Recent Comments
Un message, un commentaire ?