
Nous faisons, avant toute chose, le rappel que le monothéisme a généré, par son surgissement dans la conscience humaine, une nouvelle vision du devenir. Avec cette vision, l’humanité échappe au cercle éternel qui faisait croire que tout tournait en rond, selon des cycles plus ou moins longs, sans espoir d’une destination finale à l’horizon.
Le monothéisme affirme l’unicité de Dieu, son caractère unique, son exclusive prérogative à conduire l’histoire. Cette histoire, conduite par le Dieu omnipotent et omniscient de la conscience nationale hébraïque, prend son envol peu après l’œuvre divine de création et la chute de l’humaine condition ; elle évolue ensuite, en englobant l’humanité entière, vers une finalité unique qui est le terme absolu des temps. L’histoire, doit-on dire, est ce champ étalé entre l’Alpha-commencement et l’Oméga-fin. C’est au cœur de ce devenir linéaire, inexorable et irréversible, que Jésus surgit, comme incrustation du divin venu rassembler et unifier l’humanité, tout en lui indiquant, par sa voix incarnée, les voies qui l’attendent. À partir de ce tournant christique, tous les efforts de lecture de notre devenir sur terre se succéderont, dans un sens ou dans un autre, sans véritablement changer le principe d’une histoire qui va d’une aurore obscure, passe par de nombreuses zéniths éphémères, des étapes crépusculaires, des printemps révolutionnaires, en s’orientant, par providence divine ou par nécessité purement naturelle, vers un but qui est supposé dévoiler le sens ultime de la manifestation intra-temporelle de l’Être. Avant donc toute tentative de relecture contemporaine de notre aventure dans l’univers et d’innovation du sens de notre être au monde, il nous semble important de synthétiser, ici, avec malheureusement le risque de les caricaturer, ces grands schémas de compréhension du devenir linéaire, qui ont marqué la pensée occidentale, après Jésus de Nazareth.
Si nous écartons la possibilité, qui est impossible dans le cadre présent, de procéder à une étude, auteur après auteur, ou thématique après thématique, il ne nous reste que le chemin des grands regroupements d’idées, opérés sur la base des affinités de pensées. La pertinence de ces regroupements n’est d’ailleurs pas indiscutable, mais elle permet de traverser, en un seul regard, vingt- et-un siècles de spéculation sur la situation, les tribulations et la destination de l’homme au monde. Sous cet angle, on peut poser plusieurs étapes, plus moins légitimes, dans le devenir de la pensée de l’histoire.
On peut d’abord affirmer que l’histoire est la réalisation d’un grand plan où est tracée toute la suite des siècles. Comme l’exprime l’Ecclésiaste, sous le soleil de Dieu, « il y a un temps pour tout. » Si tout est ainsi planifié par cette divine volonté irrévocable, alors, ce qui arrive, arrive nécessairement. Dans un tel schéma, issu visiblement du fatalisme polythéiste de l’antiquité et de sa version philosophique des stoïciens, toute vie, tout avènement, relève de la prédestination. Toute chose est prévue dans le plan préétabli, avant d’être appelé à l’existence, au moment et à l’endroit précis, pour un but nécessaire à la suite du devenir.
Face à cette conception orthodoxe, les efforts des théosophes des siècles suivants consisteront à justifier le mal et le désordre qui se manifestent dans le devenir. De quoi s’agit-il exactement ? Si tout est prévu par Dieu, c’est que les maux de l’histoire lui incombent aussi. Mais est-il possible de dire que Dieu est responsable du mal ? Manifestement, la réponse est non. Alors d’où vient le mal, si visible dans l’histoire ? La Torah juive, qui correspond à l’ancien testament de la chrétienté et aux fondements du texte coranique de Mahomet, avait trouvé une solution, en attribuant la responsabilité du mal à Lucifer, ange créé par Dieu, mais déchu par lui. Pour la Torah, la bible et le coran, c’est Lucifer et les égarements de la liberté humaine conquise par le péché originel, qui sont les causes du mal. Mais, comment comprendre que des créatures, de l’omnipotent Dieu, perturbent la réalisation du plan divin ? À l’orée du siècle des Lumières, cette grave question de la conscience humaine face à l’historicité est donc encore là, crucialement posée : d’où viennent les maux et toutes ces catastrophes que connaît la suite des temps ?

La solution imaginée par les théosophes, a consisté à prononcer le non-lieu en faveur de Dieu. Dieu n’est pas responsable du mal dans le système des choses, parce que dans ce système, il n’existe pas de mal. Déjà, à l’époque médiévale, Augustin d’Hippone avait opéré une tentative de résorption du dilemme, en voyant, dans l’histoire, deux cités bien distinctes : la cité de Dieu et celle des hommes. Pour Augustin, la cité de Dieu, en édification progressive dans l’histoire, de nature purement spirituelle, ne connaît aucun mal. Le mal est par contre inhérent à l’autre cité, qui est celle des vanités humaines, le royaume de César, le cours de la vie des puissances terrestres. Cette cité a vocation à s’effondrer, pour que l’autre triomphe au terme des temps historiques. Les théosophes de la modernité, vont naturellement renoncer à cette vision manichéenne de l’histoire proposée par Augustin. Un survol qui irait de Spinoza à la philosophie hégélienne de l’histoire, en passant naturellement par la théodicée de Leibniz, permettrait de voir que le dualisme manichéen a disparu dans la conceptualisation du devenir historique. Pour les théosophes, c’est bien Dieu, dans une position classique et orthodoxe qui transcende le monde, ou dans cette autre position imminente au monde, comme chez Spinoza et Hegel, qui gouverne le monde. Dans sa gouvernance, Dieu produit toujours le meilleur des mondes possibles. Dieu travaille, pour ainsi dire, en regardant son grand but ; eut égard à ce but, tout est bien et rien n’est mal. Voltaire se fera d’ailleurs le porte-parole de cette pensée répandue dans le milieu déiste du siècle des Lumières : « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles de Dieu », répète, inlassablement, Pangloss, dans « Candide ou de l’optimisme ».
Au bilan transitoire, on peut retenir que dans ce foisonnement de pensées, tantôt irrationnelles et mystiques, tantôt rationalistes, la dialectique de Hegel apparaît comme le paroxysme du cogito historiciste dans la pensée spiritualiste d’occident. Avec Hegel, Dieu s’est fondu dans la nature comme esprit du monde, et il doit se réaliser dans l’histoire. Pour atteindre ce but suprême, Dieu dispose des passions humaines qu’il utilise, à bon escient, pour construire ou détruire les moments concrets de son devenir. Hegel met clairement fin à la dichotomie augustinienne des deux cités. Pour lui, l’histoire est unique. C’est à travers les puissances terrestres que Dieu s’exprime, combat ses moments dépassés, pour faire triompher des étapes plus hautes et plus nobles de sa vie historique. Moïse et le Pharaon, Alexandre le Grand, Jésus, César, Napoléon Bonaparte, tous sont des visages de Dieu agissant dans le devenir, comme Hegel lui-même est l’incarnation suprême de l’Esprit-Dieu qui se pense. Malheureusement, à cette même époque de Hegel, dans l’enclos même du philosophe-Dieu, une nouvelle génération surgit ; cette génération, à la faveur des connaissances scientifiques cumulées sur la matière et le vivant, portera le doute sur l’existence de Dieu. De la même manière que le monothéisme s’est nourrit des failles du polythéisme, cette nouvelle orientation de la pensée, profitera de l’absence de toute base empirique à la croyance en un Dieu aux reines de l’histoire, pour véhiculer l’idée nouvelle d’un devenir exclusivement opéré par les forces matérielles du monde. Certains déistes avaient déjà soutenu que Dieu est créateur du monde, mais qu’il n’intervient pas dans l’histoire. Nietzsche en profitera pour déclarer solennellement sa mort, ce qui signifie le dépérissement d’une superstition qui pesait nuisiblement sur la conscience humaine. Les marxistes, eux, à la suite des thèses matérialistes de Feuerbach, font vider la pensée hégélienne de son contenu spirituel et œuvrer à la promotion de quelque chose qui prendra ce sobriquet célèbre de matérialisme historique. Comment le devenir historique s’opère-il alors sur ces bases nouvelles, sans Dieu, sans diable et sans aucun autre esprit suprême que celui de l’homme lui-même ? Ce sera là le point de départ de la prochaine étape de nos réflexions.
Zassi Goro ; Professeur de Lettres et de philosophie
Kaceto.net





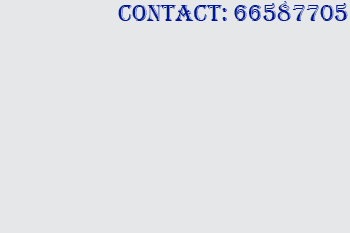






Recent Comments
Un message, un commentaire ?