
Le chroniqueur de Kaceto.net poursuit sa réflexion sur le processus de démocratisation en Afrique en s’interrogeant sur la place et le rôle de l’ethnie dans la formation du citoyen ?
Sachant que la démocratie de type libéral repose sur l’abandon volontaire de la souveraineté de l’individu au profit du mandant, il s’en suit que les réflexes ethniques, régionalistes ou claniques observées lors des consultations électorales sur le continent sont aux antipodes des valeurs démocratiques.
Est-il permis de penser que dans un avenir plus ou moins proches, les Africains se libèrent des liens naturels pour opérer des choix politiques basés sur le choc des idées ?
C’est à cette question que tente de répondre Zassi Goro. Le texte étant assez long, nous le publions en deux parties pour en faciliter la lecture et surtout son appropriation par le lecteur.
Notre précédente publication a consisté à ramener, en la mémoire du présent, ces événements, plus ou moins violents, qui ont préparé et manifesté l’émergence de nouvelles pratiques démocratiques en Afrique. Nous y avons montré comment ce grand vent glacial, venu des confins de la Sibérie des Soviets, avait balayé le monde , emportant, sur son passage, toutes les digues qui faisaient obstacles au triomphe définitif des peuples contre les multiples formes d’autocratie, de tyrannie politique et d’embrigadement des masses populaires.

Évidemment, ces années de turbulences donnèrent l’impression que l’histoire faisait le grand procès de la « dictature du prolétariat » et de sa variante dite « démocratie populaire ». Néanmoins, ce ne fut pas uniquement les partis communistes, porteurs de ce socialisme dit scientifique, légué par Karl Marx, Lénine ou leurs postérités, qui sombrèrent sous la clameur des peuples ; tous les régimes politiques à parti unique et centrés sur des hommes politiques auto-consacrés « guide éclairé » ou « père de la nation », furent emportés par les vagues déchaînées des mers de l’histoire. Ceux qui résistèrent, particulièrement en Afrique, eurent juste le temps de rendre le dernier hommage aux timoniers adulés comme au Togo, au Zaïre, en Côte-d’Ivoire, au Gabon, en Guinée Conakry, ou alors, de donner plus de force au vent du changement. Ce vent arriva d’ailleurs, tel l’apocalypse, à la faveur du « printemps dit arabe », mais qui fut également africain, pour déraciner, avec cette violence inouïe, des baobabs comme Zine el-Abidine Ben Ali de Tunisie, Hosni Moubarak d’Égypte, Mohamad Kadhafi de Libye. Dans l’ensemble, le cours des événements, étalé entre 1990 et 2012, a laissé comprendre, en Afrique, qu’il n’était plus possible de régner sans la volonté du peuple et sans le respect des libertés d’opinion politique. Il en est résulté des constitutions nouvelles qui ont consacré le multipartisme ; des calendriers électoraux dont les mises en œuvre furent confiés à des structures considérées impartiales, du genre CENI au Burkina Faso-Commission Électorale Nationale Indépendante. C’est alors dans une approche critique de cette orientation républicaine des peuples africains que nous sommes amenés, ici, à nous poser l’une des questions les plus essentielles de la gouvernance politique en Afrique : « le cap de l’ethnocratie a-t-il été réellement dépassé sous l’ère de la renaissance démocratique ? »

D’abord, il nous faut faire la précision qu’en soi, l’ethnocratie, au-delà des clichés communs, n’est pas un mal absolu. D’un point de vue conceptuel, elle n’est pas à confondre à l’ethnisme. Le mal radical, c’est l’ethnisme en tant que perception culturelle ou en tant qu’idéologie structurée, qui prône une hiérarchie des ethnies et l’exclusion de celles considérées viles. De cette hiérarchisation, il découle toujours des inégalités de dignité et de droit. De l’autre côté, l’ethnocratie, elle, n’est négative que si elle est sous-tendue par un ethnisme de fait, de préjugés socio-culturels ou de droit, qui attribue des privilèges politiques ou de dignité à une ethnie au détriment d’autres ethnies. En dehors de ce cas de figure, qui est malheureusement le plus fréquent dans l’histoire, l’ethnocratie exprime un certain contenu positif ; elle tend à traduire l’idée que la souveraineté appartient à toute l’ethnie plutôt qu’à un clan, une noblesse de caste, une famille théocratiquement élue ou tyranniquement imposée, etc.
On le voit tout de suite, technocratie ne peut ainsi être anoblie que si les frontières de l’État coïncident avec une identité culturelle unique. Dans ces conditions-là d’ailleurs, l’ethnie constitue une nation dont elle est le socle historique, et un peuple cimenté par des valeurs d’une même sève nourricière. Ce type d’État a été très rare dans l’histoire, pour la simple raison que les nations, surtout celles enracinées dans des traits biologiques ou culturelles, ne se sont posées qu’en s’imposant, comme l’a bien perçu le philosophe allemand Hegel.
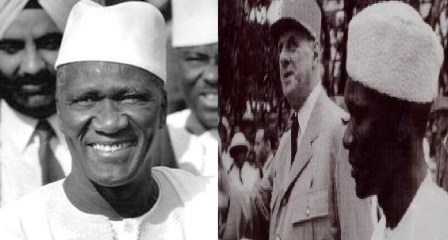
À chaque fois qu’une ethnie a pu s’ériger en nation, elle a fini, tôt ou tard et en extension impérialiste, par assujettir d’autres ethnies qu’elle a mises sur le banc des groupes sociaux inférieurs. Il faut ici penser au sort des juif dans l’Égypte pharaonique, des peuples non grecs à Athènes, des non latins à Rome, des Indiens dans l’Amériques du conquistador et du cowboy, des peuples africains colonisés par l’occident chrétien et cartésien. On peut alors déduire de cette expérience du passé le constat que toute nation, dont les horizons sont exclusivement balisés par les repères d’une ethnie, est vouée à secréter de l’ethnisme, exactement comme la nation allemande produisit le nazisme hitlérien ou comme la nation juive engendra le sionisme. Beaucoup d’entités nationales africaines auraient, peut-être, suivit ce même cheminement, s’il n’y avait pas eu le fait colonial ! Mais il y a bien eu le fait colonial dont l’intention, en Afrique, était la négation de toute identité culturelle des colonisés, pour que le nègre, le berbère et l’arabo-africain deviennent des Français tropicaux ou sahariens, des Allemands de la mangrove, des Anglais de la savane, des Espagnols et des Portugais de la bananerais d’Afrique . En dépit de la particularité de « l’indirect roll » prôné par l’administration anglaise, cette colonisation, baptisée, avec fanfare, du beau sobriquet de « mission civilisatrice », envisageait, purement et simplement, l’assimilation des peuples d’Afrique aux identités et aux nations d’Europe. Mais la réalité, que les idéologues de l’assimilation découvrirent, contrasta largement avec leurs spéculations européocentriques qui niaient toute histoire aux peuples indigènes. En lieu et place des tribus primitives, anhistoriques et barbares, purs produits de leur imagination, ils rencontrèrent, en effet, des nations organisées, des identités culturelles multimillénaires et inaliénables. Dès lors, tout se compliqua pour les missionnaires colonialistes et le choc des civilisations fut inévitable un peu partout sur le continent.

C’est alors en utilisant les ethnies les unes contre les autres, en opposant les nations qui furent des alliées dans le passé, en humiliant les forces patriotiques les plus rebelles à l’assujettissement, en ridiculisant les valeurs spirituelles des peuples, que le système colonial put tenir au-delà du demi-siècle. Malgré tout et au bout du compte, la mission civilisatrice dû reculer. Elle ne s’annula pas, car, le colon, bousculé par l’histoire, avait eu le temps de laisser, sur place, une élite d’indigènes aliénés à son mode de pensée, et surtout, des États dont les contours géopolitiques niaient les entités nationales pré coloniales et minaient, dangereusement, la stabilité des futures nations africaines souveraines. L’Afrique, trop fière de sa toute nouvelle souveraineté acquise, n’avait peut-être pas pensé à cet aspect des choses ! Mais lorsqu’il fut question de tracer les pourtours de son avenir dans le concert des nations, elle prit conscience de ses déchirures mortelles ; elle fit, en effet, l’amère constat de cette balkanisation qui a démembré le Mandé et agrégé des peuples divers à l’Empire du Mogho ; supprimé la Casamance, le Macina, le Fouta ; regroupé, dans une explosive marmite pour Félix Houphouët Boigny , le Baoulé, le Dioula, le Sénoufo, l’Agni et le Bété ; assujetti le Tutsi au Hutu au Rwanda et au Burundi ; opposé, dans le pays de Jomo Kenyatta, le Kikuyu au Luo ; désorganisé les nations Bantou, morcelé le Fang, le Lingala, le Batéké ; allié, de fait, au Nigéria, le Haoussa, le Ibo et le Yorouba ; abandonné le zulu au féroce système raciste de l’apartheid.

Ce sont, en réalité, des États gravement empoisonnés qui accédèrent à la souveraineté dans ces années 1960. Cependant, dès lors que l’Afrique « avait préféré la liberté dans la pauvreté à l’esclavage dans l’opulence », comme pu le dire le turbulent Ahmed Sékou Touré de Guinée, on pouvait s’attendre à ce qu’elle soit aussi capable d’apporter l’antidote nécessaire au mal que le colon, avant de battre en retraite, avait machiavéliquement inoculé à ses ex territoires. C’était là d’ailleurs le défi le plus urgent à relever, avant celui du développement économique. Malheureusement, nonobstant le surgissement, sur la scène du monde, de l’Organisation de l’Unité Africaine et la présence massive sur le continent de forces progressistes, les défis d’édification de l’État républicain fondé sur des valeurs de diversité, de liberté et d’égalité, resteront vains.
Zassi Goro
Professeur de Lettres et de philosophie
Kaceto.net





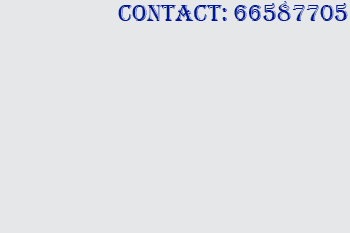






Recent Comments
Un message, un commentaire ?