
Avec pour objectif affiché de développer des semences à haut rendement, de nombreuses firmes agrochimiques se bousculent sur le marché semencier africain. De Bayer à ChemChina, en passant par DuPont Pioneer, l’enjeu est de renforcer la présence sur ce marché appelé à exploser dans les prochaines décennies. Face à cette vague, les institutions de recherche et les pouvoirs publics ont tout intérêt à revaloriser les savoirs endogènes afin d’éviter que les multinationales des semences ne captent les bénéfices du système semencier au détriment de la souveraineté alimentaire. C’est ce qu’estime Danièle Clavel, agronome et généticienne des plantes tropicales au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad)
Agence Ecofin : En Afrique, la majorité des producteurs procèdent eux-mêmes à une sélection des semences et les filières paysannes font circuler le matériel génétique, contribuant au développement de variétés adaptées aux conditions locales et à la diversité des cultures. Ce système semencier traditionnel est-il en péril, en raison de la présence croissante des multinationales ?
Danièle Clavel : Les avis sont partagés sur cette question, car cela dépend de quelles cultures et de quel contexte socio-économique l’on parle. Ce qui est sûr, c’est qu’il est impossible « d’appliquer » en Afrique le système « révolution verte » [basé sur des variétés améliorées à haut rendement de céréales, l’irrigation, les engrais et pesticides, et techniques agronomiques associées, ndlr].
La grande majorité des scientifiques s’accordent, en effet, aujourd’hui sur le fait que l’intensification agricole et la révolution verte, qui ont fait la puissance actuelle des grands groupes multinationaux de la semence, ont conduit à l’extinction de nombreuses variétés et espèces (biodiversité), à la surexploitation des ressources, notamment les ressources en eau, l’augmentation du réchauffement via les émissions de gaz à effet de serre (GES).
La riziculture intensive par exemple est responsable de fortes émissions de méthane, au 2e rang après l’élevage, un gaz au pouvoir réchauffant 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2). Je ne parle ici que de la riziculture irriguée avec lame d’eau permanente résultant d’aménagement hydraulique, au demeurant fort coûteux, réalisé sur beaucoup de grands fleuves ou lacs africains.
Ce qui est nouveau et que la science de la nutrition découvre actuellement, c’est que certaines espèces, notamment le riz et le blé, montrent des pertes de qualité nutritionnelle, sous l’effet de la pression des GES, alors que d’autres plantes, notamment le sorgho, le mil, mais aussi le maïs, maintiennent leur qualité nutritionnelle sous l’effet d’émissions accrues de CO2. Les hybrides de maïs modernes possèdent l’inconvénient majeur d’exiger beaucoup d’eau pour exprimer leur potentiel de rendement, ce n’est pas le cas des céréales locales comme le sorgho ou le mil et certains maïs ou riz locaux rustiques, nutritionnels et résistants à la sécheresse ou à l’inondation comme il en existe encore en Afrique.
AE : Certains observateurs pointent du doigt le rôle prépondérant de la Fondation Bill et Melinda Gates dans le secteur semencier africain. Comment l’organisation américaine influence-t-elle les institutions de recherche sur le continent ?
Danièle Clavel : La manne financière représentée par une fondation philanthropique à l’américaine comme celle de Bill et Melinda Gates (BMGF) est massive. Alors que la recherche agricole africaine est privée de moyens substantiels, ces fonds permettent de faire vivre des institutions anciennes, notamment sous-régionales, comme le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) et internationales comme le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR).
La BMGF passe aussi des accords avec de grandes agences comme l’Agence française de développement (AFD). Elle a aussi créé d’autres organisations de toutes pièces comme l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) et le Centre pour l’amélioration des cultures d’Afrique de l’Ouest (WACCI) basé au Ghana.
Par effet de mode ou d’autolégitimation, une institution d’enseignement supérieur sur la sélection variétale, pourtant confortablement financée comme le WACCI, se voit affecter à son tour des subsides considérables de la part de l’Union Africaine ou l’Union Européenne, de sorte qu’elles deviennent incontournables.
Or l’enseignement dispensé dans ce type d’institution d’apparence prestigieuse est mono-disciplinaire et concentré sur la sélection « moderne » et les outils de la biotechnologie. On forme ainsi une nouvelle génération de jeunes chercheurs africains, en anglais et dans l’ignorance de la connaissance des ressources végétales et savoir-faire locaux de leur milieu d’origine.

Gates est également à l’origine du Busara Center qui développe des bureaux en Afrique de l’Est, Kenya et Ethiopie notamment, et qui compte une cinquantaine de jeunes économistes, psychologues ainsi que des spécialistes en sciences cognitives. Au niveau du centre Busara (mot swahili qui veut dire « sagesse »), la nouvelle science économique du comportement (« Behavioral economics ») est à l’honneur. Le parti pris de cette discipline est que l’acteur est un individu rationnel pour qui le premier facteur de décision est son intérêt économique. On y étudie, par exemple, les mécanismes psychologiques qui président à la prise de décision par un acteur d’adhérer à un « service », comme par exemple accroître le recours des petits exploitants à l’assurance-semences.
AE : Comment les Etats africains peuvent-ils veiller à ce que les semences industrielles fournies par les grands groupes augmentent globalement les rendements, mais aussi à ce qu’elles servent les intérêts des agriculteurs qui en ont besoin pour leur sécurité alimentaire ?
Danièle Clavel : Les semences industrielles fournies ou plutôt vendues par les grands groupes, sont un mythe. Même les grands groupes savent qu’il faut développer des variétés sur place, mais leur objectif est que ces semences soient identifiables et payantes. Les Etats africains sont souverains et disposent en général des ressources humaines scientifiques capables de conduire des études originales en lien direct avec la réalité du terrain.
L’objectif d’instruire les politiques agricoles publiques afin d’accroître l’impact des recherches techniques ou sociotechniques devrait être systématiquement attaché à ce type de travail.
Ce lien direct avec le terrain nécessite l’inclusion de tous les types de savoirs et savoir-faire afin de favoriser des innovations variétales qui soient adaptées aux besoins, et que le système dans lequel les semences sont inscrites soit accessible et dynamique, c’est-à-dire capable d’évoluer à l’image des variétés elles-mêmes. La notion de dynamisme est capitale. Si l’innovation autour des nouvelles variétés est co-construite avec des actrices et acteurs locaux, elle a beaucoup plus de chances d’avoir un impact positif et d’être adaptée si le contexte change ou si une nouvelle opportunité apparaît.
C’est ce type de compétences que l’Afrique doit développer et non pas des personnes uniquement formées à « transférer » des connaissances et objets technologiques stéréotypés, directement issus de la culture occidentale néolibérale, dont la révolution agricole des années 50 a conduit à un appauvrissement inédit et très rapide de la diversité végétale et animale. Cette recherche, pour exister en Afrique sans se compromettre avec des financements intéressés par les applications commerciales, doit être inclusive. En d’autres termes, elle doit fédérer des organisations paysannes, des ONG et des groupes de femmes très organisés, notamment autour de l’agroécologie, mais qui disposent de peu de moyens. C’est ce genre de recherche variétale qui doit être favorisée. Elle commence déjà à exister et peut être très efficace sans être onéreuse.

AE : D’après un rapport de l’ONU, les variétés traditionnelles proposées dans les circuits de semences paysannes figurent rarement dans les programmes de distribution de semences subventionnées. Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour éviter la marginalisation ou la disparition progressive des variétés locales ?
Danièle Clavel : Effectivement, la nouvelle loi actuellement en préparation dans la CEDEAO sur les semences certifiées prévoit l’inscription sur un catalogue variétal national et un système de certification fortement inspiré du système de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) établie par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce système a été créé pour protéger commercialement des variétés créées par des professionnels, la plupart du temps hybrides. L’homogénéité génotypique et phénotypique est nécessaire à l’inscription, car il faut pouvoir reconnaître la variété pour la vendre et que l’obtenteur touche des royalties. Une variété hybride ne peut pas être resemée, car elle perd tout son intérêt en deuxième génération. D’où l’intérêt pour les hybrides ou les OGM des sociétés commerciales.
Mais cette recherche d’invariabilité empêche les mécanismes d’adaptation naturels de s’exprimer. On homogénéise et on intensifie le milieu (irrigation, engrais, traitements phytosanitaires) afin d’obtenir le rendement visé. Mais si quelque chose manque ou change dans le milieu (appauvrissement du sol de la monoculture par exemple, la production chutera massivement. Ce système va à l’encontre de la sélection paysanne qui agit sur des populations végétales qui intrinsèquement possèdent une adaptabilité valorisée et sélectionnée par les producteurs en fonction de leur milieu et de leurs besoins.
Beaucoup d’organisations paysannes en Afrique sont opposées à une telle loi sur les semences « qui ne laisse pas le choix » et qui nécessitera une infrastructure de contrôle totalement inexistante à l’heure actuelle au niveau public. Le danger est donc bien celui que pointent ces organisations, c’est-à-dire que des intérêts privés, ceux des multinationales de la semence, captent les bénéfices du système au détriment de la souveraineté alimentaire.

AE : Les agriculteurs reçoivent souvent des semences industrielles dans le cadre de programmes d’aide. Comment est-ce que les producteurs peuvent entrer en contact avec des semences privées sans pour autant perdre la main sur leur semence paysanne ?
Danièle Clavel : C’est une question complexe car chaque contexte est différent et souvent les familles paysannes s’adaptent à des situations qu’elles n’ont pas pu choisir. Je pense que, globalement, la culture économique dominante pour le développement ne distingue pas suffisamment les cultures de rente, dont les produits sont destinés à être vendus au profit d’une filière organisée (comme la tomate de conserve au Sénégal), et les cultures alimentaires. Alors que les paysans dans leurs choix familiaux, eux, font bien cette différence, afin que chacun trouve sa place, et limitent le risque alimentaire. Une partie des produits des cultures de rente peut être consommée, comme l’arachide, de même qu’une partie des produits des cultures alimentaires peut être vendue sur les marchés locaux.
Classiquement par exemple, les surplus non consommés du maraîchage réalisé par les femmes sont vendus dans les marchés locaux. Ces marchés ainsi que les cuisines sont des espaces d’intenses partages de savoirs, de recettes mais aussi de semences. Cette dimension fortement anthropologique des recherches agricoles doit être rattachée de façon étroite aux études d’innovation et de développement sur les variétés végétales et leurs usages. Le rôle de la recherche et des pouvoirs publics doit être recentré sur la reconnaissance et le développement des savoirs endogènes locaux, c’est la condition sine qua non de la reprise de liberté et d’autonomie des agriculteurs familiaux sur leur production et leur alimentation et peut être sur leur santé et sans doute sur leur bien-être.
Propos recueillis par Espoir Olodo
Agence ECOFIN





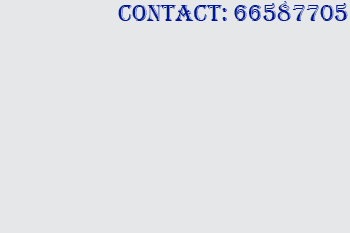






Recent Comments
Un message, un commentaire ?